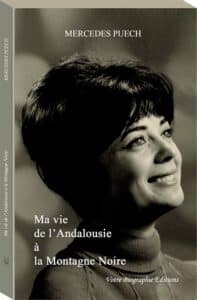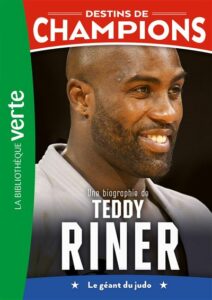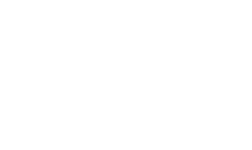Les souvenirs d’immigrés Espagnols
Biographie d’une communauté
La présence espagnole a beaucoup augmenté dans l’Hexagone après la première guerre mondiale à tel point que les Espagnols représentent la troisième nationalité étrangère à partir des années vingt. Au début, les Espagnols travaillent surtout dans l’industrie et l’agriculture, spécialement dans les vignobles du Midi. La plupart sont journaliers. Seul un quart des ouvriers espagnols est qualifiée, contre 75 % de la main d’œuvre française.


Des générations de mieux en mieux intégrées
La crise de 1929 et la politique protectionniste qui s’ensuit stoppent radicalement les flux d’immigration en France. Des quotas sont votés visant à limiter le recours à la main d’œuvre étrangère dans l’industrie et les services. Quant aux chômeurs étrangers, ils risquent l’expulsion. A partir des années 1934 et 1935, le nombre d’Espagnols sur le territoire français chute de plus de 100.000 personnes. Dans le même temps, les demandes de naturalisation augmentent chez tous ceux qui sont mariés avec une Française ou qui souhaitent se marier. La guerre civile espagnole, la Seconde Guerre mondiale et la fermeture de la frontière pyrénéenne qui s’ensuit provoquent la perte des liens avec le pays d’origine. Cette rupture de lien s’aggrave d’autant plus que la deuxième génération de migration s’intègre bien en France, trouve des emplois qualifiés et pérennes. Les mariages mixtes franco-espagnols continuent à se développer.
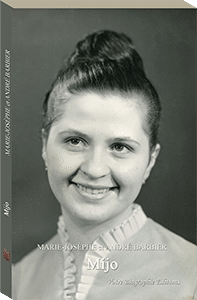
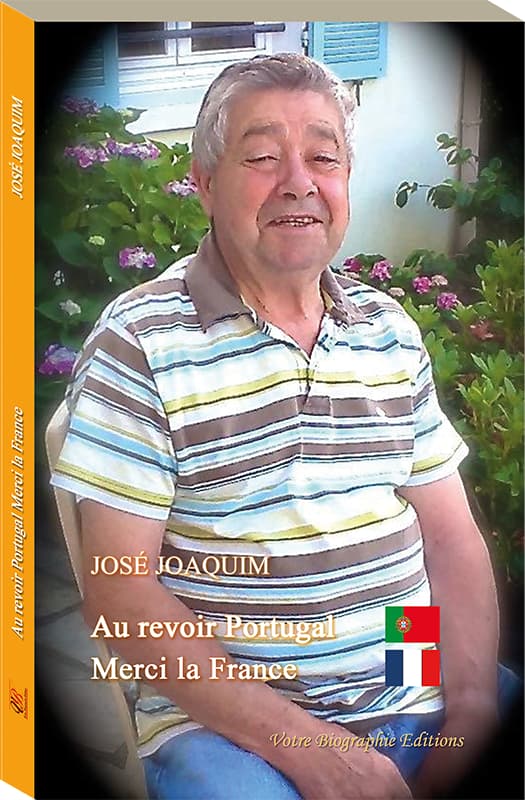
Les mémoires d’immigrés portugais
Récits de voyages éprouvants et dangereux
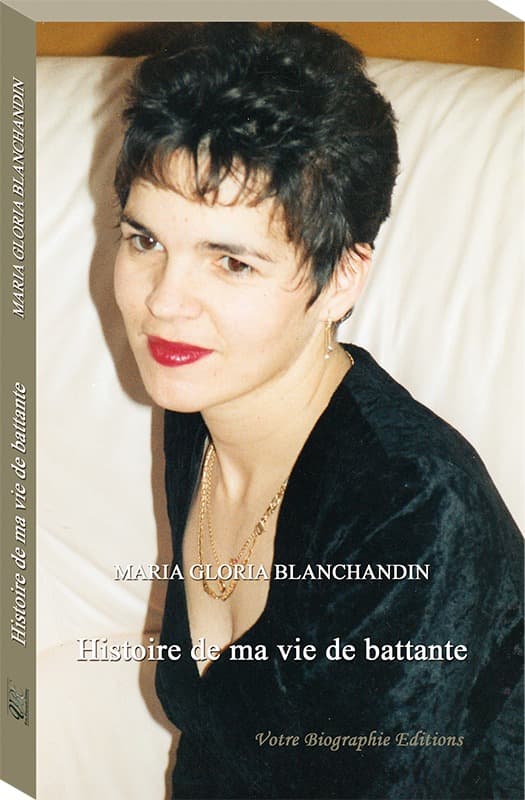
Explications des différentes migrations
A la fin des années soixante, les départs vers la France explosent littéralement. La raison de cette migration est d’abord économique. Le Portugal, très rural, peine à nourrir sa population. L’industrie, très peu modernisée, ne peut répondre aux demandes. « Il était prévu que je m’embauche dans la construction, comme beaucoup de Portugais. Mais à la saison où nous étions, les intempéries empêchaient encore le travail. Je devais attendre. Finalement, on m’a proposé de m’embaucher chez un maraîcher à Thiers. J’ai accepté pour quatre cents francs, nourri, logé », explique José Joaquim dans son livre qui aborde essentiellement la traversé de la frontière en 1964.

Mais il y a aussi des causes politiques de quitter le pays. De nombreux Portugais craignent la dictature qui génère un système socio-économique rigide, sans mouvement dans lequel il devient très difficile de trouver un travail. C’est pourquoi l’exode est massif. « Sous Salazar, la vie était dure. Impossible de critiquer notre dirigeant, sous peine d’emprisonnement immédiat dans une société très policière. Depuis tout petit, nous apprenions à respecter le curé, les gendarmes, le président de la commune, les professeurs et les parents. Et à vouvoyer tout le monde, parents compris. », raconte notre client Gabriel Alves dans son livre.