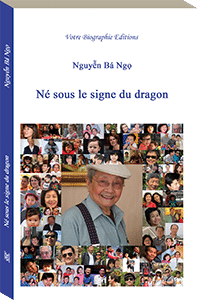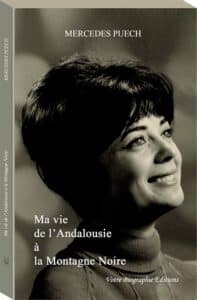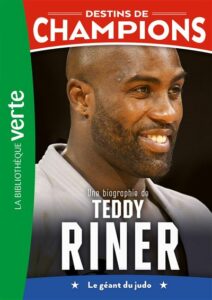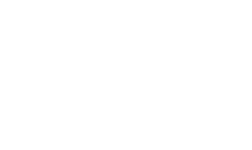Contrairement à la guerre d’Algérie qui a mobilisé des centaines de milliers d’hommes, la guerre d’Indochine a été réservée aux seuls volontaires, des hommes aguerris, des durs à cuire. Depuis dix-huit ans que nous recueillons des témoignages historiques d’hommes et de femmes ayant connu ces périodes très tourmentées pour la France, nous avons donc édité énormément de livres sur le conflit algérien (lire notre article sur la guerre d’Algérie) mais très peu sur celui de l’Indochine. Mais s’ils sont rares, les témoignages de cette guerre sont riches et diversifiés, émanant de sources très différentes, qu’il s’agisse des Vietnamiens réfugiés en France eux-mêmes, des Français expatriés à Saïgon dans les années 50 ou des militaires français engagés dans cette région. A noter que plusieurs biographies de Vietnamiens ont été réalisées à l’aide d’un auteur traducteur.

Mémoires de soldats français rescapés des combats
« Avec mon père, on se disait : Pourvu qu’on échappe à l’Indochine… Ça nous paraissait tellement loin, l’Indochine… On ne voulait surtout pas y aller. Finalement, ce sont surtout les volontaires qui sont partis… », s’exclament François Detrans dans son ouvrage autobiographique, véritable journal de bord sur ce conflit. Cet extrait témoigne de l’effroi, l’angoisse que pouvait représenter une éventuelle mobilisation pour l’Indochine. Mais qui s’intéressait à ce conflit au sortir de la seconde guerre mondiale ? Très peu de gens en fin de compte… En quoi consiste ce conflit ?
Après la capitulation du Japon qui occupait l’Indochine jusqu’alors, les Alliés se mettent d’accord pour que le territoire soit libéré par les Chinois au Nord et par les troupes anglaises au Sud au profit des Français lorsqu’ils pourront déployer leurs propres forces sur le terrain, ce qui n’est évidemment pas possible en 1945. Profitant de la complexité de la situation, Ho Chi Minh, le leader indépendantiste vietnamien communiste déclare l’indépendance le 2 septembre 1945.
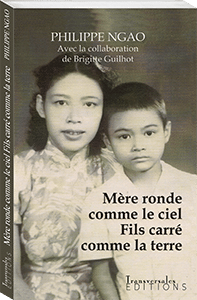
« Après avoir expérimenté la guerre contre les Allemands, mon envie de continuer à me battre est grande. Mais pas question que cela soit simplement pour avoir une arme à la main. Mon combat doit avoir une finalité claire. Elevé dans un esprit empreint de traditions par une famille de notables militaires, j’appartiens comme mon père à un courant de pensée légaliste qui fait de nous des républicains convaincus. Ce dernier avait été très malheureux des décisions prises pendant la Seconde Guerre Mondiale par un chef pour qui il nourrissait une grande admiration, née alors qu’il combattait l’ennemi allemand sous ses ordres durant la Grande Guerre. L’Indochine, je le sais, réunit tous les critères que je recherche. », raconte Marcel Barois dans son livre.

A l’instar de toute guerre menée contre un ennemi qui défend son propre territoire, la guerre d’Indochine se caractérise par des pièges, des guet-apens permanents. Les Français peuvent passer plusieurs jours à ratisser une jungle foisonnante sans apercevoir la moindre forme d’ennemi et tomber subitement sur une embuscade ravageuse. Bernard de Malsan se souvient : « La dizaine d’hommes que nous étions prirent place à bord d’autos mitrailleuses blindées et nous nous mettions en route. Bien entendu, les Viêt ont été prévenus de notre expédition et nous tendirent une embuscade. Ils ont rendu la piste impraticable en y aménageant de profonds trous creusés tantôt sur le bord gauche, tantôt sur le bord droit. J’étais bel et bien bloqué. Les balles commençaient à pleuvoir sur nous… »